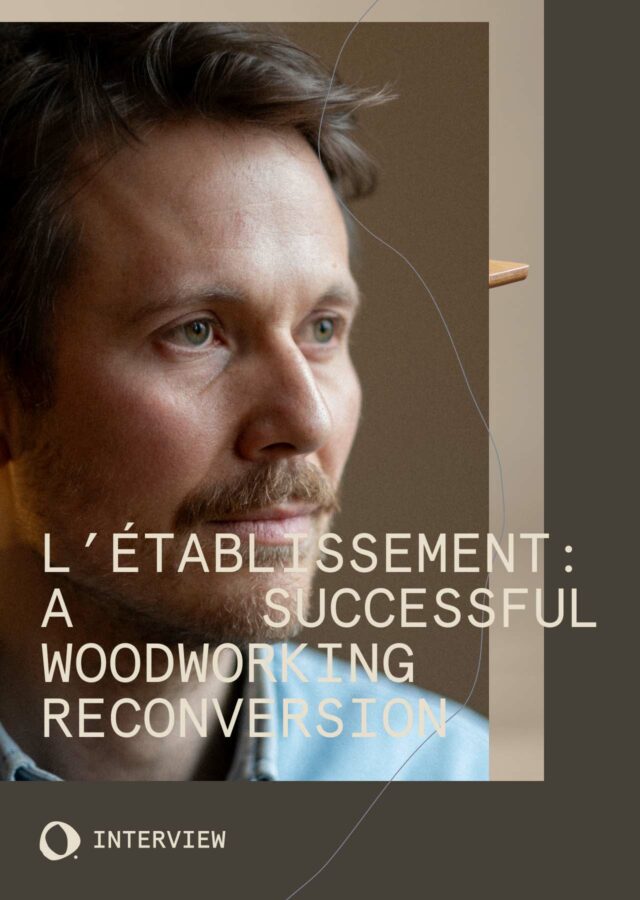Cédric Breisacher—Vers un atelier zéro-déchet


L’artiste aux multiples talents, ébéniste, sculpteur, chercheur et créateur du biomatériau Agglomera nous accueille dans son atelier pour une conversation fascinante autour de ses passions
English version here→
Après ta formation en design industriel et quelques années de travail, tu es retourné étudier à l’ENSCI pour approfondir la théorie et la gestion des déchets. Quel impact ces études ont-elles eu sur ton travail ?
Après mon master en ingénierie du design à l’ISD Valenciennes, j’ai développé une passion pour la fabrication de maquettes malgré des installations limitées. C’est lors de mon stage chez Valentin Loellmann que j’ai découvert le travail du bois. Ma formation était principalement méthodologique, avec un manque ressenti au niveau théorique, notamment concernant les grands penseurs du design comme Bruno Munari, Andrea Branzi et William Morris.
J’ai créé mon atelier avec la volonté de produire localement des objets en bois massif, m’approvisionnant dans le nord de la France. Mon objectif : créer des objets durables et respectueux de l’environnement. Face à l’accumulation de copeaux de bois, j’ai d’abord mis en place un système de revalorisation, puis décidé de reprendre mes études à l’ENSCI pour approfondir ma recherche et développer de nouvelles méthodologies.


Après ton passage à la CoFabrik de Lille, tu t’es installé au JAD de Paris, un autre atelier partagé. Au-delà des avantages pratiques comme le partage des machines stationnaires, que t’apportent ces lieux partagés par rapport à un atelier indépendant ?
Le premier avantage, c’est clairement de travailler ensemble plutôt que d’être seul dans son atelier — sa « grotte » — et de pouvoir échanger quotidiennement avec des gens de notre pratique et d’autres disciplines. Cela crée un quotidien, une routine différente. Il y a une énergie qui se déploie dans un atelier partagé mais j’ai toujours travaillé dans des espaces qui incluaient des ateliers privés, ce qui me permet de m’isoler quand j’en ressens le besoin.
La particularité de l’atelier du JAD, c’est son équipe administrative et culturelle qui anime le lieu et organise des journées professionnelles. On y rencontre des architectes d’intérieur, des curateurs, et on nous encourage à présenter notre travail dans des formats courts de 10 minutes. Ces exercices de présentation orale deviennent précieux lors des salons ou des conférences.
C’est un lieu dynamique qui ne se limite pas à notre travail individuel. On nous incite à collaborer entre nous, ce qui permet la rencontre des pratiques, le dialogue des savoirs, et crée des ponts inattendus entre le design et l’artisanat.


Dans ta soutenance, tu parles d’objets relationnels et tu définis le rapport affectif de l’humain pour l’objet matériel. En tant que designer sculpteur, est-ce que tu penses que tu peux influencer la relation que les acquéreurs ont avec tes productions ?
Je pense que oui, car lorsqu’un collectionneur ou quelqu’un achète une de mes pièces, c’est souvent par un lien affectif qui se crée dès le premier regard. Les acquéreurs sont généralement déjà amoureux du travail, ou tombent sous le charme de la ligne, de la courbe, ou de l’histoire que je raconte à travers les objets. C’est amusant, par exemple, quand j’ai offert un tabouret comme celui-là à ma copine, elle a passé toute la soirée à le prendre dans ses bras. Il y a une énergie que je transmets à mes objets, notamment à travers le travail à la gouge, qui crée un rapport très charnel avec le matériau — tout est travaillé à la main, tout est fait avec affection. Ce travail à la gouge, comme tu peux le voir derrière toi, établit un rapport direct avec le matériau et crée nécessairement une symbiose entre le créateur, la création de la pièce et le matériau. La pièce finale devient ainsi la synthèse de toute cette méthodologie et cette démarche.


Et toujours sur ce sujet, peux-tu nous parler de ta relation avec l’outil et comment il influence ta pratique et ton style ?
Il y a eu deux temps dans ma pratique. Au début, j’ai commencé avec une meuleuse équipée d’un disque Arbotech, l’outil classique des sculpteurs. Cet outil permet de dégrossir le bois sans guide ni référence. C’est vraiment le geste du corps qui s’imprime dans le bois. J’ai commencé par sculpter des plateaux comme celui-là, où l’outil, prolongement du bras et de la main, vient s’inscrire dans les formes du bois. L’outil réagit différemment selon la densité du bois : face à un nœud, il va juste effleurer la surface, alors que dans les parties plus tendres, il va creuser d’un coup. Je cherche à développer ce dialogue entre le matériau et l’humain, où l’outil joue le rôle de médiateur entre les deux. L’outil devient ce lien essentiel entre la surface du bois et ma main. Comme un microphone, il permet d’établir un véritable dialogue entre le matériau et mon geste.

“La gouge est vraiment un outil qui permet de comprendre le matériau et d’établir un rapport égalitaire avec lui. J’ai ma direction, le bois a la sienne, et de cette confrontation naît une harmonieuse balance.”
As-tu un outil pour lequel tu as un affect particulier, qui guide ta façon de travailler ?
C’est la deuxième partie de mon évolution dans le travail manuel. Au début, j’utilisais uniquement de l’outillage électrique — c’était un peu la solution de facilité. L’outil électrique ne prend pas en compte le fil du bois ; on peut sculpter même à contre-fil. Puis progressivement, j’ai réintégré des outils manuels tranchants, qui nous obligent à respecter le sens du fil et le matériau. Il faut l’écouter, le regarder, travailler avec lui et non contre lui.
Parfois, c’est la matière elle-même qui fait naître une forme : on rencontre un nœud, on retravaille à la gouge, on compose avec le contre-fil, on creuse, et une forme émerge naturellement. Dès que la trace du geste est belle, je m’arrête et la pièce est fixée. C’est pour cela que dans mes dernières créations, notamment la collection “Intuitive Archaïsme”, le travail à la gouge devient crucial. Après le dégrossissage à la meuleuse, toutes les formes finales sont définies par le travail à la gouge.
La gouge est vraiment un outil qui permet de comprendre le matériau et d’établir un rapport égalitaire avec lui. J’ai ma direction, le bois a la sienne, et de cette confrontation naît une harmonieuse balance.

Qu’est-ce qui t’a poussé à choisir le bois comme matière de prédilection ? Est-ce que tu as d’abord eu l’envie de travailler ce matériau avant de te lancer, ou est-ce que tu as commencé par le design industriel avant de découvrir le bois ?
Le bois a toujours fait partie de ma vie. Dans ma famille, nous sommes propriétaires forestiers. Tous les hivers, à Noël, nous allions nous balader dans la forêt de mon grand-père. Le bois a toujours été présent, même si je ne l’ai réalisé que tardivement. J’ai vraiment commencé à découvrir ce matériau lors d’un stage chez Valentin Loellmann, designer, sculpteur et artiste basé à Maastricht. Il travaille principalement le bois, mais aussi le métal. J’avais déjà une affection particulière pour ce matériau — pendant mes études, je dessinais beaucoup d’objets en bois tourné…
Pour moi, le bois représente le matériau par excellence de l’objet renouvelable et durable. Quand j’ai ouvert mon atelier, je voulais travailler avec une matière locale, et la proximité de la forêt près de Lille a renforcé ce choix. Une fois qu’on commence à travailler le bois, il est difficile de s’en détacher.

Ton travail oscille entre le mobilier fonctionnel et l’œuvre d’art sculpturale. Est-ce une volonté délibérée de mélanger ces deux univers, d’insuffler de l’art dans des objets quotidiens, ou plutôt un désir de maintenir une présence dans chacun de ces domaines ?
En fait, il existe aujourd’hui une frontière très poreuse entre l’art et le design. Je ne cherche pas particulièrement à m’inscrire dans une catégorie spécifique. C’est plutôt mon processus de travail qui définit cette approche : je n’utilise aucun gabarit, donc chaque pièce est unique puisque chaque morceau de bois est différent. Je ne peux pas reproduire les objets à l’identique, d’autant plus que ma pratique intègre de plus en plus d’éléments sculpturaux. Cette unicité est intentionnelle — je souhaite créer des objets toujours différents et stimulants à réaliser. La production en série me paraît trop répétitive et ne correspond pas à ma méthode de travail. Cette porosité entre les disciplines est d’ailleurs cruciale aujourd’hui. Nous avons la chance de vivre à une époque où nous pouvons remettre en question ces frontières traditionnelles. Ces objets, situés à la frontière entre art et design, nous permettent d’explorer des concepts plus théoriques, de créer des objets manifestes qui questionnent nos modes de vie et notre rapport aux objets. Cette démarche ouvre la voie à la recherche et permet de présenter des créations qu’on ne trouve pas habituellement dans le commerce.



Revenons sur ce que tu expliquais concernant la continuité entre le muscle, le geste, l’outil et ta manière intuitive et instinctive de travailler. Peux-tu décrire cet état, un peu comme Jackson Pollock entrant dans une sorte de transe ?
Oui, c’est assez similaire. Quand je passe plus d’une heure à sculpter, il y a un moment où je m’oublie. C’est pareil sur le tour à bois — tu oublies tout ce qui t’entoure et tu es totalement concentré sur l’instant, sur le geste. C’est comme une chorégraphie. Le mouvement, pour moi, se ressent jusqu’à la pointe des pieds. C’est vraiment comme de la danse : quand je commence une sculpture par la gauche, le geste part vers la droite, les épaules tournent, le bassin suit, et parfois je me retrouve même sur la pointe des pieds. C’est un véritable plaisir, purement instinctif. Il y a de l’intuition, une osmose, une euphorie — tout en restant maîtrisée, bien sûr, car il faut respecter les gestes de sécurité. Ces précautions font partie intégrante de ma chorégraphie de sculpture.
Le défi, c’est de savoir quand s’arrêter. On pourrait sculpter pendant des heures sans fin, mais il y a toujours un moment où, naturellement, un équilibre se crée dans l’ensemble.
Que ce soit la fatigue musculaire ou le rapport des formes entre elles, je sens quand je n’ai plus besoin de sculpter. La pièce atteint un autre état, comme une nouvelle forme de vie. Je la sors alors de l’atelier, je la laisse vivre dans l’espace, j’observe comment elle prend la lumière. Si certains aspects de ses formes me déplaisent, je retouche légèrement pour atteindre une parfaite harmonie.

Peux-tu nous parler de ta résidence de l’année dernière en Suède dans le cadre du programme MIRA, et de ce que tu as appris du savoir-faire et du design scandinave ?
J’ai réalisé cette résidence avec Marion Gouez, designer textile spécialisée dans les motifs pour grandes marques, dans le cadre du projet Végétamorphe (Programme PRIC—Projet Recherche Innovation Collaborative du JAD). Notre collaboration visait à s’inspirer du vivant pour créer des processus techniques innovants. Nous avons commencé par développer une toile jacquard, créant des motifs à quatre mains qui représentaient l’écorce d’arbre. Notre approche était très instinctive : nous créions d’abord un fond avec des copeaux de bois trempés dans l’encre, puis nous ajoutions progressivement des détails de mousse et de lichens à la craie et à la peinture.
Le motif évoluait comme une mise au point photographique, passant du flou au net, créant différentes couches de lecture. La résidence MIRA en Suède nous a permis d’approfondir cette démarche. Pendant notre voyage de 20 jours, d’Abisko jusqu’à Hurtrask, nous nous sommes immergés dans les forêts de pins et les paysages glacés du Nord.
Inspirés par la philosophie de Soetsu Yanagi sur l’interprétation du vivant dans l’artisanat japonais, nous avons développé une approche où le geste technique traduit l’essence naturelle. Cette réflexion, combinée à la rencontre d’un artisan local spécialisé dans le bois cintré, nous a conduits à créer la chaise ‘bra’. Cette pièce marque un tournant dans notre travail : plutôt que de sculpter la nature, nous créons des objets reproductibles qui en capturent l’essence même.


Parlons de ton engagement envers la production circulaire dans ton atelier, notamment à travers ta dernière série Not Wasted ? Peux-tu nous décrire le concept de cette série et tes démarches pour démocratiser l’Agglomera ?
L’Agglomera est un matériau que j’ai développé pendant mon master à l’ENSCI. C’est un mélange de copeaux de bois, de fécule de pommes de terre et d’eau — de l’amidon.
C’est une colle organique que je continue de développer pour agglomérer les copeaux et créer une nouvelle matière qui me permet de revaloriser et recycler mes rebuts de production. Le concept derrière cette matière, c’est de pouvoir transformer mon atelier en espace zéro déchet. C’est d’ailleurs l’origine du nom Not Wasted. Ce matériau présente plusieurs avantages : il peut être compressé en plaques dans des moules, mais aussi modelé, permettant ainsi une pratique additive plutôt que soustractive. Dans la chaise Not Wasted, je combine les deux approches : le piétement en bois massif, par sa sculpture soustractive, génère exactement la quantité de rebuts nécessaire pour créer l’assise en agglomérat. La conception est modulaire : les trois piétements, selon leur agencement, peuvent créer différentes formes, et c’est la technique de modelage qui définit la fonction finale, comme celle de la chaise. C’est le premier concept de la série Not Wasted. Le second concept vise à représenter l’idée du cycle, notamment dans la série de tables d’appoint et de lampes. Dans ces pièces, je mêle le bois dans trois états différents de son cycle de vie, permettant à l’utilisateur de voir le matériau dans son état naturel, façonné, puis recyclé, éveillant ainsi une conscience écologique.


Tu parlais de d’essayer de populariser ça sous un système open source ?
Je n’ai pas encore publié ma recherche, donc la recette n’est pas disponible sur mon site internet. Par contre, je démocratise la recherche à travers des ateliers et des workshops — j’en fais environ 3 ou 4 par an. On me sollicite maintenant pour animer ces ateliers Agglomera, où je partage cette recette d’amidon. Ces workshops fonctionnent toujours très bien car les participants réalisent qu’ils peuvent utiliser de nombreux matériaux qu’ils ont déjà chez eux. C’est une recette que j’ai choisi de ne pas breveter car elle appartient selon moi au bien commun, vu sa simplicité de mise en œuvre : de l’eau, de la fécule de pomme de terre, et on obtient une colle. J’utilise aussi d’autres adjuvants comme du glycérol, de l’huile, du vinaigre, selon les propriétés recherchées pour le matériau, et je transmets ces connaissances pendant mes ateliers. Même si ces sessions sont souvent trop courtes pour approfondir tout le développement des matériaux biosourcés, l’essentiel est dans la démarche et la pratique de créer une colle accessible à tous avec des rebuts disponibles. Pour moi, c’est là que se situe actuellement l’aspect démocratique.
Et la deuxième ambition, c’est de créer avec Agglomera une maison d’édition qui fabrique en série des objets moulés, principalement pour créer une économie liée aux rebuts et valoriser une ressource présente dans mon atelier.

Comment tu définirais le style de ton travail et qu’est-ce que tu penses de l’attribution de style pour des artistes en créateur comme toi ?
Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. J’ai tendance à me dire « bon, on verra quand je serai mort » quel style on va m’attribuer. Pour l’instant, je ne me pose pas trop la question. Il y a certains mots qui reviennent, comme « organique ». Je me définissais aussi comme minimaliste, mais maintenant, même si j’apprécie beaucoup le minimalisme, je trouve que ça ne reflète pas vraiment ma pratique.
On observe un mouvement qui s’est développé depuis plus d’une dizaine d’années, particulièrement aux Pays-Bas et en Belgique. En France, nous avons plus de difficulté à établir ce mouvement. Nous sommes davantage orientés vers un design lié à la mode, plutôt qu’un design où les créateurs revendiquent l’innovation technique.
En termes de mouvance, je me sens plus proche de l’approche néerlandaise, où l’on travaille vraiment le matériau et où l’on développe des processus singuliers. Et pour le style, c’est clairement organique, voire biomorphique…
Sensoriel aussi, peut-être ? Oui, c’est ça — organique et sensoriel, ça correspond bien.

Quel est le futur de Cédric Breisacher ? À moyen terme, quelles sont tes prochaines activités, et à long terme, dans 10 ans ?
Bonne question ! Je ne vois que sur 3 ans — je rigole ! À moyen terme, il y a plusieurs expositions. L’année 2025 va être assez chargée : la Biennale Émergences en avril, Collectible Fair en mars avec la Lune Galerie, la Biennale Amour Vivant à l’automne, et une exposition avec Objects with Narratives en avril aussi, je crois. Et probablement une participation à la Paris Design Week, mais je n’ai pas encore candidaté. Voilà pour les expositions à très court terme. Concernant le développement, mon occupation au JAD se termine en 2026, dans un an et demi. Il va falloir changer d’atelier.
Ce changement d’atelier va probablement s’opérer en Bretagne, où je compte continuer à travailler dans un lieu collectif — et peut-être même le créer avec un autre ami designer, Frédéric Saulou. Nous allons nous associer pour avoir un atelier pérenne où je pourrai m’installer durablement et disposer d’espace pour réaliser des projets encore plus ambitieux en sculpture. Dans trois ans, je serai également autonome en bois, car nous venons de reprendre la gestion forestière de mon grand-père. Nous avons fait une coupe cet hiver, donc je devrais avoir du bois pour travailler d’ici trois ans. Cela signifie la mise en place de mon propre circuit de matière et de ressources. Cette autonomie et ces bois, chargés d’histoire, me permettront peut-être de m’orienter davantage vers des pièces sculpturales pour le marché de l’exposition et de la galerie, où j’ai vraiment envie de déployer la sculpture à plus grande échelle. En parallèle, je souhaite développer le laboratoire Agglomera pour commercialiser une première série d’objets. Dans dix ans, l’objectif est d’avoir un atelier Agglomera distinct de l’atelier de fabrication bois.
Hâte de suivre tout ça ! Pour finir, quel conseil donnerais-tu au jeune Cédric Breisacher de 10 ans ?
Ah, j’aime bien cette question ! Au Cédric de 10 ans, ce petit garçon qui courait partout et n’écoutait pas en classe, je lui dirais de se faire confiance et que tout ira bien. Ce n’est pas grave si tu ne penses pas comme les autres — c’est justement un avantage et une force. Ne vois pas ta différence comme quelque chose qui te marginalise, mais plutôt comme ce qui te rend unique et singulier. Tu as le droit d’être différent.